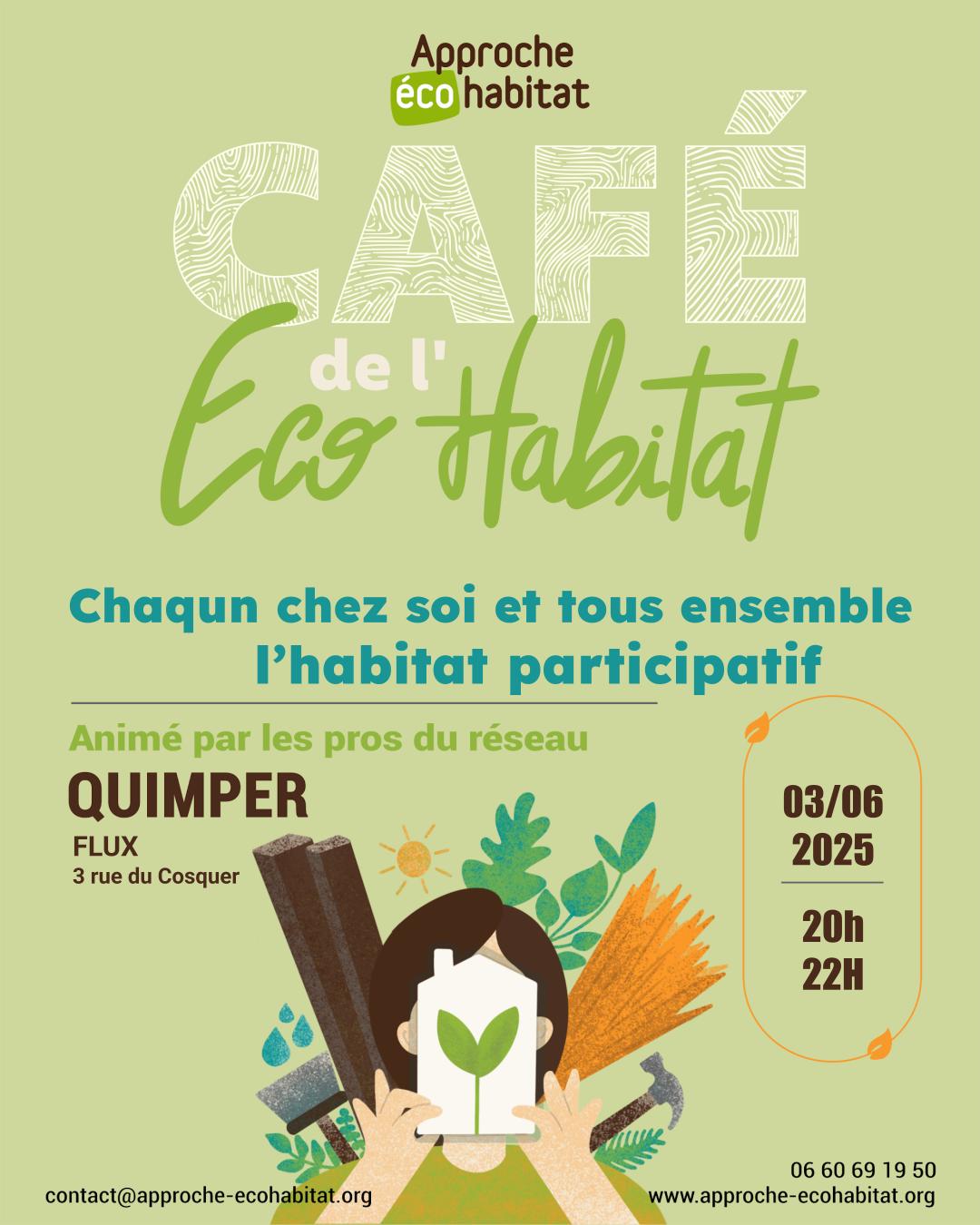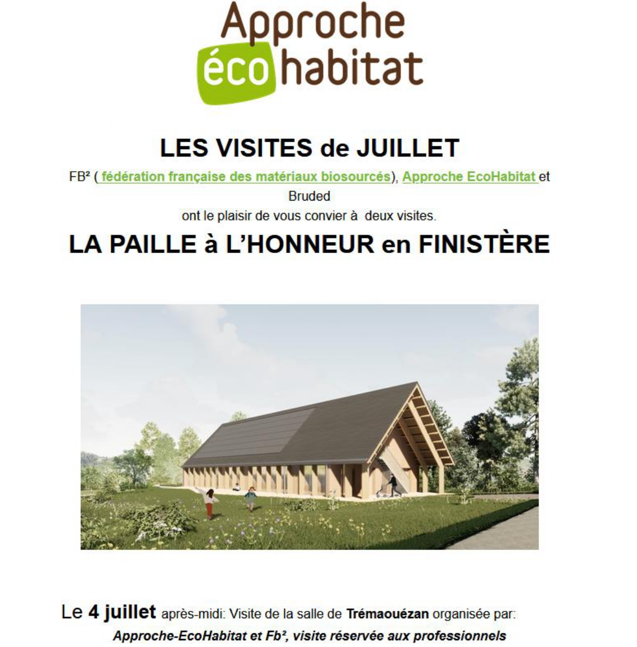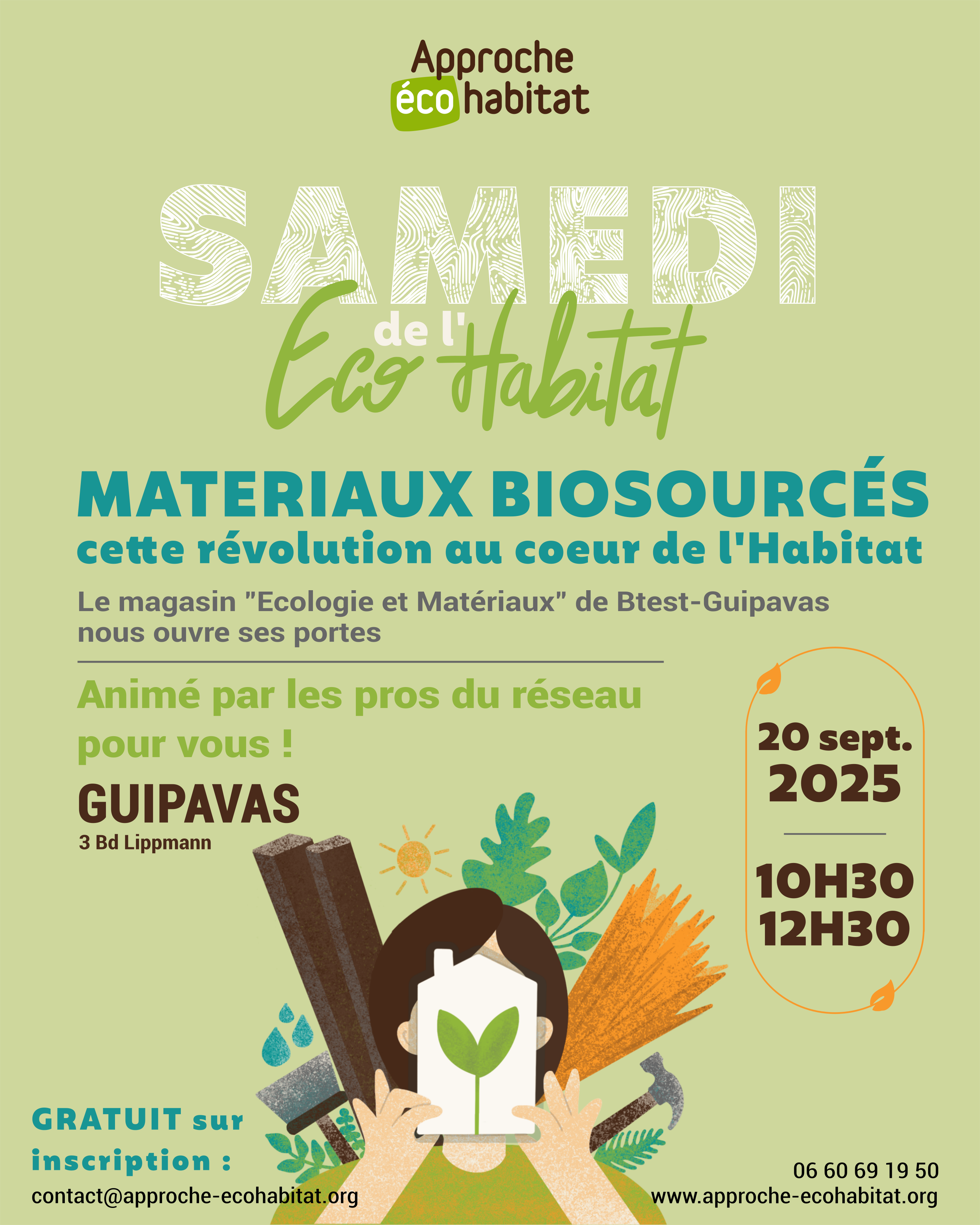Le film Toucher terre explore la construction en terre crue, une matière si commune, si modeste, qui révèle pourtant de surprenantes propriétés dans l’architecture. Le premier pas consiste à la regarder autrement. Tout au long du lm, des interventions d’experts en architecture, en histoire, en sciences et en technique de construction, viennent s’articuler avec l’avancée d’un chantier dit « participatif ». Un groupe d’apprentis y découvre comment façonner à la main un mur en terre, avec simple ajout de paille et d’eau trouvées sur place, sans aucune cuisson, suivant une ancienne technique locale.
La construction en terre crue est née avec l’architecture, en Mésopotamie voici 11 000 ans environ, avant de se développer sous toutes les latitudes avec une prodigieuse variété de techniques. Quantité d’édifces, des plus simples aux plus prestigieux, témoignent toujours de son rôle de premier plan dans l’histoire de l’architecture. La Grande Muraille de Chine elle-même comporte des sections en terre crue. Aujourd’hui, une écrasante majorité des chantiers utilise le même matériau : le béton de ciment. L’architecture se retrouve standardisée, sans lien avec les contextes naturels et culturels, sans souci de l’exploitation inconséquente des ressources.
Récemment la science s’est intéressée aux matières non transformée. En particulier la matière en grains, comme la terre, s’est révélée une source inépuisable de passionnants sujets de recherche. Quelques modestes expériences dévoilent déjà d’étonnants phénomènes de diverses matières naturelles.
Si l’ajout d’eau rend la terre argileuse plus collante, au contraire un ajout plus conséquent la conduit à se désagréger. Mais certains principes architecturaux permettent de rendre les édifices en terre pérennes, même en des climats relativement humides. Cette action érosive de l’eau s’exprime spectaculairement parmi des falaises d’ocres de Provence, mises en valeur par les couleurs jaune, rouge, blanche de la terre, loin du seul marron
de l’imaginaire collectif.
Ailleurs, dans d’anciennes maisons en terre habilement rénovées, des habitants font part de la douceur de l’ambiance intérieure, dont la terre régule naturellement la température, l’humidité et l’acoustique.
Sous un vaste hangar, une imposante machine semi-automatisée fabrique un long mur de terre par compactage de couches successives de terre. Après leur coupe par une scie circulaire, les fragments de mur sont ensuite réassemblés sur site, pour former un bâtiment dont les dimensions impressionnantes sont permises par ce système constructif.
Dans le calme d’un chantier sans aucun bruit de machines, de jeunes artisanes appliquent avec attention des enduits en terre. Ne nécessitant aucune protection pour la santé, et pouvant aussi se travailler sans outils dangereux, ce matériau se révèle très inclusif et valorise facilement le travail de chacun. Construire un mur en terre amène souvent à construire de meilleures relations humaines. Pour celle qui encadre ce chantier,
travailler au contact de cette matière encourage même une dimension méditative.
Sur le chantier participatif, certains apprentis malaxent cette fois l’eau et la farine et forment une pâte. Puis dans la soirée des pizzas sont cuites au feu de bois d’un four en terre, avant d’être partagées avec toute l’équipe autour d’une jolie tablée, improvisée parmi les outils du chantier. Un photomontage vient clore le film, où le mur en terre continue de s’élever pendant que changent peu à peu les visages des participants. Une architecte fait
alors part de sa confiance en l’avenir de la construction en terre, confortable et si peu consommatrice d’énergie. Le matériau terre retrouvera la place qu’il a toujours eu et pourra soutenir la résilience des générations futures.